Extrait 1
Prologue
Des routes sinueuses, des maisons en planches et tôles, des enfants à demi vêtus qui s’ennuyaient. Des hommes oisifs, des femmes débordés. Des malades qui ne se plaignaient jamais et des bien portants ingrats. Des chômeurs qui n’avaient aucun espoir. Des filles en quête de mari. Des fonctionnaires incapables de joindre les deux bouts. Des commerçants escrocs. Une jeunesse rompue au vol.
Une vie débridée ; tout allait trop vite. Trop vite pour que le présent soit vécu, trop vite pour entrevoir le futur. Trop vite pour faire un bilan et tirer des conclusions, trop vite pour des regrets, trop vite pour qu’une joie, aussi éphémère soit-elle, s’épanche. Trop vite pour se marier ou divorcer. Trop vite pour avoir un sentiment humain comme exprimer sa colère, laisser libre cours à son amour, secourir son prochain et se rendre utile à la communauté. Trop vite pour n’être finalement qu’une bête fourbue par une fuite en avant vers un univers irréel, des chimères.
L’idéal ne se trouvait que dans un mot : incha Allah. Les écoles et les hôpitaux seront bâtis incha Allah. L’eau et l’électricité pour tous incha Allah. Les emplois, une vie décente, la richesse et le bonheur qui n’avaient existés que dans les discours au fond des mabrazes…incha Allah. Mot magique qu’était cet incha Allah. Incha Allah pour ne plus penser à rien, pour ne rien faire surtout. Il suffisait de dire incha Allah pour ne pas s’acquitter de la dette ou finir un travail qui traînait à longueur de mois. Incha Allah masquait l’incapacité et corrigeait bien des défauts qui minaient la vie. Surtout il matait les revendications et calmait, jusqu’au incha Allah prochain, la révolte qui couve sous l’aspect résigné des pauvres. Incha Allah…incha Allah.
Une conscience claquemurée dans la misère. Incapable de se défaire de lourdes chaînes de dépendance pour enfin faire un retour en soi et s’adjuger une identité. .
Extrait 2
Naissance
Godoria, le restaurant chic de la ville. Un vieux bâtiment de deux étages, de style colonial. Des larges arcades en béton logeant des fenêtres en bois moisi défiguraient son front délabré. Pas de jardin. Aucune terrasse. Il se tenait là, dans la ville bruyante comme un navire fantôme sur une mer houleuse. Tout autour de lui des poubelles nauséabondes s’amoncelaient. Les passants ne daignaient guère jeter un coup d’œil vers cet amas de béton silencieux. Pourtant des voitures raffinées stationnaient non loin de là. Des gens bien habillés entraient et sortaient sans cesse.
L’intérieur était tout autre chose. Le rez-de-chaussée était une longue salle croulant sous la tapisserie. Les murs étaient peints avec les couleurs nationales ; c’était la salle de monsieur tout le monde. Le novice se croirait dans une Moukbasa [1]ordinaire même si le matériel et le personnel sur son trente un feraient penser à un certain degré de raffinement.
Par contre l’étage ne recevait qu’une clientèle restreinte. Des gens bien connus, presque familiers à force de revenir chaque après-midi. Un vigile se tenait immobile comme la justice au ras de l’escalier. Il ne parlait à personne ; il ne saluait pas non plus ni du regard ni à l’aide de son chapeau. Un bien étrange personnage aux yeux rouges qui laissait quand même choir les bakchichs dans sa poche ostensiblement ouverte. Son rôle était de filtrer les arrivants, dans la discrétion. S’il venait à rencontrer une tête inconnue il consultait le propriétaire du lieu qui se trouvait en face de lui, tout au fond de la pièce, du regard. Un clin d’œil fixait le sort de cet intrus.
L’étage n’était qu’une succession de petites salles tenues au frais et fort sombre. Le personnel ne se composait que des filles en haillons. Le teint clair, le cheveu d’un beau noir corbeau, les dents blancs comme l’émail derrière un sourire d’enfant. Toute chose jugée gênante avaient soigneusement été dissimulé ; le client ne devait pas être effarouché, encore moins froissé.
Samatalis jouissait des prérogatives de client modèle. Il arrivait toujours à la même heure, à seize heures de l’après-midi pour ne repartir que tard dans la soirée. Il somnolait sur son divan, deux filles parfumées sous ses yeux. Ils se contemplaient ; il grimaçait et les filles telles des poupées de cire souriaient largement. La compréhension était là tout comme le doute.
Parfois il éprouvait de la pitié pour ces gamines sans but arrêté. Elles étaient ici, dans cette maison, errant sur les routes de l’enivrement, parce qu’il fallait bien qu’elles soient quelque part. Dans ce qu’elles appellent une ambiance, avec « quelqu’un ». Peu importe qui il pouvait être, ivrogne, drogué de longue date, jeune ou vieillard, malfrat. Elles offraient tout ce qu’elles pouvaient mobiliser de joie, ce qu’elles avaient de plus cher pour des instants éphémères de bonheur vain. Elles étaient mademoiselle à tout faire, à faire sourire, à faire pleurer, à subjuguer son auditoire ou à le dorloter tel un enfant bruyant.
Aujourd’hui Samatalis s’intéressait peu à elles. Il avait énormément chaud, d’une chaleur un peu particulière. Il sentait une brûlure dans sa poitrine, du feu sourdre dans ses veines. Une douleur hurlait dans ses tempes. Il avait fumé durant une dizaine de minutes, couché sur le divan.
Ce lieu lui plaisait tant. Le vulgaire arbuste était loin d’égaler cette fumée aromatisée qui l’emportait loin de son quotidien. Il préférait ce calme mortuaire, cet accueil combien simulé qui lui procurait la sensation d’être autre. La cacophonie des mabrazes lui répugnait. Là-bas il n’y avait pas de classe. Chacun ressemblait à son prochain par les manières de ruminer comme une vieille chèvre, par la pensée embrouillée qui errait parmi d’autres plus confuses et imbriquées. Il ne voulait surtout pas de la chaleur d’étuve qui régnait dans les mijilis et le relent de sueur.
Il avait tant brouté, tant bu de vin en passant par toutes les couleurs mais jamais il n’avait été satisfait. Tous avaient un arrière goût de regret, ils étaient drapés dans un brin de mélancolie qui assombrissait les heures de manque. Il passa alors au tabac cru, posé entre les incisives et la lèvre inférieur ; il ne récolta rien de bon. Et voilà qu’un beau jour il rencontra un vieil ami qui lui vanta les mérites du Godoria. Mérites qui se révélèrent à lui dès sa première visite.
Maintenant il savait le cours des choses ; dès la première bouffée il se détendait, ses muscles auparavant tendus se relâchaient doucement, très lentement des fois qu’il croyait entendre des bruits sourd filtrer de tout son corps. Puis à la deuxième son esprit obscurcit par le jeune s’éclaircissait, un jour brillant se levait sur les ténèbres de ses tréfonds. Soudain il voyait tout, sentait tout, imaginait tout. Son entourage prenait subitement forme, une vie qu’il ne pouvait jusque là imaginer. Les gens prenaient des nouveaux visages ; la malveillance de certains le frappait de plein fouet tandis que la gentillesse des autres, dont il se complaisait, s’évanouissait comme une brume matinale.
Des choses se révélaient à lui, précis. Comme son enfance, déchiré entre deux pays.
Il se rappelait de ce jour de Décembre pluvieux. Djibouti n’avait guère connu de pareil depuis longtemps. Pour le tout jeune Samatalis cela signifiait du repos, un jour de classe raté. La ville était inondée, son école en premier. L’oued d’Ambouli qui divisait la ville en deux part égale coulait ; tantôt ses flots enragés mugissaient entre les palmiers dattiers, rasant sur son passage toute l’herbe que pouvait offrir les bordures sablonneux et escarpés ; tantôt l’eau jaunâtre perdait leur fureur dévastatrice pour ne plus devenir qu’un immense lac de sable.
Le pont n’existait pas à cette époque. C’était plutôt une route rectiligne, étroite, parsemée de nids de poules. A la hauteur de l’oued le bitume laissait place à des larges dalles de béton. Et de part et d’autre de la voie on pouvait voir des cailloux grand comme des montagnes, ténébreux. Une alarme enchâssée à l’intérieur d’un coffre en fer se dressait sur la rive sud, niché sur un piton en béton. L’alarme se déclenchait automatiquement dès que l’eau de l’oued atteignait un certain niveau critique.
Il était donc chez lui, allongé sur le lit. Sa mère l’incitait à dormir en le couvrant d’un drap ; le voir jouer dans la boue du quartier ne lui plaisait guère. A la saison des pluies les quartiers se transformaient en immense marécage. Les gens cherchaient un coin au sol résistant et dès qu’un se manifestait une queue interminable se formait. Les femmes se déplaçaient doucement, glisser était pour elles fatale, le diric relevé jusqu'à la hauteur du genoux. Les voyous, non moins nombreux, les pervers, les éternels dépités de sexe, les insatiables de chair tendre, les poltrons, les handicapés morales, s’offrait alors un grand plaisir, assis à un coin d’ombre.
[1] Restaurant servant un plat local composé notamment de poisson.
Extrait 3
L’école de La Salle
Samatalis fréquentait l’école de La Salle. Une école entretenue par des missionnaires français, payante. La somme était dérisoire, cependant le fait de payer à lui seul inquiétait beaucoup la famille extrêmement pauvre. C’était une école très prisée, car c’était là le dernier bastion de l’éducation de qualité.
Le pays était libre, le colonisateur officiellement parti. L’état bâtissait une conscience nationale à coup de grand slogan et des discours à tout bout de champs. Les occasions pour mobiliser la foule ne manquaient guère, les fêtes religieuses, la célébration du jour de l’indépendance, l’anniversaire de telle ou telle composante de l’état, les funérailles d’un dignitaire. On parlait de la lutte, célébrait sans relâche la victoire, célébrait les martyrs, honorait les rescapés, vantait haut et fort le courage des mères, louait chanteurs et autres artistes sans oublier de remercier tous ceux qui avaient contribué à la libération.
Mais les esprits, au fond, restaient fidèles à ce blanc qui avait apporté, avec l’oppression, une autre manière de vivre, qui avait réussi à casser les traditions et bouleverser l’espace nomade. Même si les souvenirs qu’il avait légués ne remuaient guère les âmes, il symbolisait indéniablement la réussite au sens propre comme au figuré. Les relations avec cet homme n’avaient rien de passionnel, c’était juste une sorte de troc où chacun trouvait son compte.
Tant que le blanc était là, instruisait et conduisait ses enfants démunis vers le succès, le passé douloureux perdait de son importance. Pas plus qu’un mauvais cauchemar que les politiciens dépoussiéraient lors des campagnes électorales. Et, bizarrement, la réalité de l’éducation nationale donnait raison à l’homme blanc. Non parce qu’une majorité non négligeable de l’élite du pays avait psalmodié La Marseillaise dans ces établissements, mais que les écoles publics laissaient à désirer. Sous-équipées, bondées, les incompétences éclataient au grand jour.
Les déficiences du système poussaient une population en quête d’identité vers l’être qu’elle avait été amener à abhorrer. Les échecs récurrents, les désillusions qui tournaient au cauchemar, la soif matérielle qui ne se désaltérait jamais, finirent par embellir l’image de « l’ennemi », il était subitement débarrassé de son froc d’oppresseur et s’imposait instantanément comme une alternative souhaitable.
Pour Samatalis tous cela n’avait aucune importance. Il allait à l’école, un cartable sur le dos et c’était l’essentiel. Il ne connaissait le blanc que par ouï-dire. Et maintenant qu’il fréquentait son école, son influence ne dépassait jamais l’enceinte. Il était un maître qui lui inculquait des concepts loin de la réalité djiboutienne. Ces notions ne lui expliquaient aucunement le pourquoi de sa vie de misère, ils n’apportaient aucune réponse à son lendemain comme ils restaient muets sur le passé de ce pays dont il croyait appartenir de chair et de conscience. Ce qui se disait en classe contrastait beaucoup avec la vérité désagréable de la rue. Rien de l’école de blanc ne lui appartenait tout simplement.
Pour nombre de ces enfants, l’école était, du moins au début, une corvée. A la longue c’était devenu un espace de jeu comme n’importe quel autre, rien de plus.
***
Le premier contact entre Samatalis et le blanc avait été brutal. C’était le premier jour de classe. Il n’avait que six ans. Quand il arriva devant la porte de l’école accompagnée de sa mère, le lieu grouillait de monde. Une cohue indescriptible.
Un grand homme blanc vint, tenant des feuilles dans sa main droite. Il était affreusement chauve et portait des lunettes. Bien habillé, une grosse montre scintillante au poignet, il dégageait une certaine odeur qui ne manquait pas d’irriter les narines de Samatalis. Cette peau blanche, rouge par endroits, parsemée de veines vertes ou d’artères bleuâtres ne lui inspirait pas confiance. Lentement une peur sournoise gagnait son esprit.
L’homme se tint devant la porte, droit, tenant les feuilles entre ses mains potelées il égrena les noms des nouveaux inscrits un à un. L’enfant cité passait à côté de lui, rentrait par la porte entrouverte pour rejoindre une dame, blanche elle aussi, au milieu de la cour.
- C’est le père Bernard, lui souffla un écolier plus âgé que lui. Il est méchant comme mille bandits réunis.
- Et comment tu le sais ?
- Je suis en classe de CM2 et toi ?
- Je commence aujourd’hui. Il fait quoi ce père ?
- Tu vas voir comment c’est dur l’école de La Salle. Une vraie galère. Et la maîtresse de la classe de CI est un monstre. Tu vois la dame qui se tient dans la cour non ? C’est elle. Tu sais ce qu’elle fait quand un élevé ne cesse de crier ?
- Non, répondit Samatalis.
- Elle lui met un bâillon autour de la bouche, le prend par les pieds comme une poule et lui met la tête dans un seau d’eau qui sert à essuyer le tableau.
- C’est la mort !
- Elle le garde juste un instant. Demande à tout le monde, elle est célèbre ici. Chambaraie qu’elle s’appelle. Regarde ses bras comme ils sont musclés.
- Les élèves ne se plaignent jamais ?
- Se plaindre de quoi ?
- De la maîtresse qui les maltraite.
- C’est la maîtresse, pourquoi se plaindre ?
- Même ma mère ne m’inflige pas un tel traitement.
L’écolier lui tapota l’épaule tout en souriant.
- Ici c’est l’école de La Salle, pas la maison. Prépares-toi à des choses que tu n’as pas connu auparavant et que tu ne vivras qu’ici, nulle part ailleurs.
Puis il porta un regard alangui sur l’école et secoua la tête, l’air navré. Il mit une main sur la tête de Samatalis et ajouta.
- Tu dois être fier d’être ici en ce moment petit. Pour ma part, je reviendrais toujours rendre visite à cette école. Elle est formidable quoi qu’en dise les gens.
Samatalis ne savait pas encore de quoi être fier de ce lieu lugubre. Il était plutôt récalcitrant à toute forme de punition physique. Et que celle-ci lui soit infligée par une personne autre que ses parents était tout simplement inconcevable.
« Va mon grand, lui dit sa mère, c’est ton tour. Le directeur a appelé ton nom. »
Il fut soudain foudroyé de peur. Une sensation bizarre, effrayante, d’angoisse profonde se saisit de lui. Une sensation étrange, inhabituelle, pour le moins désagréable. L’allure du directeur conjugué avec les histoires sur la maîtresse avait jeté un voile noire sur son esprit.
D’ailleurs le lieu n’avait-il pas un aspect sinistre ? Une solitude sévère de prison ? Un mur cendreux surmonté d’un grillage poussiéreux, bordé au nord par un terrain vague, sablonneux, où s’amoncelaient les ordures. Des ânes étaient là, éreintés par la dure labeur durant la journée sur les routes défoncées sous une soleil de braise, comme moyen de transport communément appelé « gadhi ximaar[1][1] ». La journée qui commençait ne leur présageait rien de bon. Pensifs, ils étaient soit debout sur le reste d’une herbe sèche qu’ils avaient ruminé durant toute la nuit, soit assis, adossé à la charrue qu’ils traîneront derrière eux comme un boulet de canon.
Un peu plus loin, une brigade de Gendarmerie qui irradiait de tristesse, accolée à un cinéma vétuste, Le Paris. Vieille bâtisse gothique avec son front haut et ses larges colonnes. Au sud, un terrain vide au sable rouge. Et derrière lui, une cité à l’architecture anachronique, la cité du stade. Entre les deux, une route au goudron incertain.
L’intérieur reflétait bien cette austérité poignante. Des grands arbres à l’écorce profondément ravinée serraient l’enceinte entre leurs bras dénudés. Une nuée de corbeaux menaient la danse de bienvenue. Leur cri strident noyait parfois la voix orgueilleuse du directeur. Ce qui l’obligeait à élever un peu la voix.
Tout au fond, les classes formaient un L inversé de quatre vingt dix degrés dans le sens des aiguilles d’une montre. Le toit bas, ils étaient peints en gris. Une habitation ratatinée sur elle-même était adossée au mur, coté sud.
La cour au sable rouge, très large de dimension, ne portait aucune trace de gazon. Apparemment elle n’avait été touchée qu’avec les pieds. En la parcourant du regard Samatalis pensait ne jamais sortir de ce lieu de désolation. Non seulement il ne passerait pas inaperçu dans cette cour nue où les rayons du soleil s’y reflétaient comme sur un miroir parfait, mais il aurait certainement perdu le souffle avant d’atteindre la porte.
Il songeait à ce qu’allait être maintenant sa vie. Dès qu’il passerait la porte, il revêtirait certainement la tenue à rayures des prisonniers. Il ne casserait certainement pas des pierres, mais creuserait ses méninges toute la journée et traînerait tel un boulet son cartable en carton.
Le stylo serait sa pioche, les cahiers ses pierres et les leçons n’étaient pas loin des discours du geôlier dont il fallait suivre à la lettre. Cet univers ressemblait bel et bien à une prison du Far West.
Il serait peut être un Dalton et côtoierait des bandits de grand chemin. Il priait que les bandes dessinées qu’il avait vues à la télé aient un tant soit peu de vérité pour qu’il espère encore une évasion qu’il lui paraissait de plus en plus improbable.
Il vint à tout regretter, le quartier, les jeux brutaux, sa liberté de gambader, les amis cruels, les voisins indifférents. Tout ce qu’il avait honni à Balbala devint subitement merveilleux. Il réalisait qu’il avait jusqu'à présent vécut à sa guise, libre de ses mouvements, de sa pensée, de sa colère, de sa joie, de lier amitié avec qui il voulait, désirer comme un gamin, refuser comme un être capricieux, aimer comme une femme à l’aube de sa ménopause, haïr comme un vieux tyran, idolâtrer comme le dernier des imbéciles une chose insignifiante et ignorer l’essentiel ; finalement tout lui avait été accessible à Balbala.
Face à la désolation de l’école, Balbala revêtit un charme qu’il ne lui avait pas connu. Plongée dans la misère depuis longtemps elle en avait acquit une certaine fierté insondable, presque une arrogance. Elle arborait ses maisons délabrées, ses rues poudreuses. Elle regardait passer les voitures raffinées des riches avec un regard de pitié. Ces gens là étaient pauvres, pas elle. Les sentiments qui existaient chez elle leur étaient inaccessibles. Ils se cachaient du soleil, de la chaleur, des parents et de la famille entière, ils craignaient le voleur et le gueux. Ils ne pouvaient pas supporter le regard d’autrui et vivaient dans la tourmente propre à leur univers.
Brusquement tout avait changé, pas pour le meilleur pensait-il. Dorénavant il y aurait une heure pour se coucher, une autre à se réveiller, des choses à faire et d’autres qu’il fallait oublier. Des amis à qui s’attacher et d’autres à ne pas approcher. Des habits utilisables tandis que d’autres seraient relégués aux oubliettes.
En l’amenant ici, devant la porte de l’école, sa mère venait de le condamner. Il savait que le but de l’école était de le façonner. Pour regagner sa liberté, il devait répondre à certains critères. C’est-à-dire avoir une manière de penser, de penser, de s’habiller, de manger, de dormir et de se réveiller, de gérer ses jours et de mourir. Des manières acceptables par tous. Il n’avait donc rien à lui, tout était social, il n’avait même pas à décider quoi que ce soit, on l’enfermait pour qu’il apprenne tous ce dont on attendait de lui. Il ne devait rien concevoir, tout avait été conçu pour lui, il lui suffisait d’aller à l’école.
« Va mon fils, disait sa mère en le poussant un peu. Tu ne vois pas que les autres entrent ?»
Samatalis refusait de partir. Il espérait encore qu’elle change d’idée. Tout cela était une farce, elle n’allait pas le laisser aux mains de ces blancs et s’en aller, elle qui avait toujours comblé par l’amour, par sa présence combien réconfortante, le vide matériel de leur vie.
Le jeune écolier se mit à pleurer. Il s’accrochait désespérément au boubou de sa mère. Tout en larmes il suppliait de ne pas le laisser ici, qu’elle l’envoie partout ailleurs mais pas à l’école.
- Mais maman qu’y a-t-il ?
- Je ne veux pas !
- Qu’est-ce que tu ne veux pas ? Cet école ou fréquenter l’école ?
- Je ne veux pas d’école ! Retournons chez nous !
- C’est pas possible maman, regarde les enfants de ton âge, tu vois qu’ils rentrent à l’école non ? Soit grand mon fils et ne me fais pas honte. Vas-y, je viendrais te chercher à midi.
Rien n’y fit. Le père Bernard regardait Samatalis par-dessus les feuilles qu’il tenait devant ses yeux. Il s’impatientait. Quand il entendit Samatalis hurler à gorge déployée, il s’arrêta de lire puis baissa les feuilles. Comme tout homme irrité dans l’exercice de ses fonctions, il fronça les sourcils.
D’un pas alerte il traversa la foule et vint se tenir sur Samatalis qui cria plus fort. Il se saisit du maigre bras de l’enfant et l’arrachant de force des jupes de sa mère, le pris sous le bras comme un vieux journal maintes fois lu qu’il ne paraissait plus utile. Puis il le déposa devant la dame et revint finir ce qui lui restait de son travail.
[2][1] La voiture de l’âne.

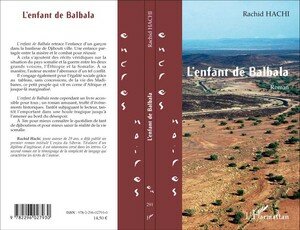


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F116891.jpg)